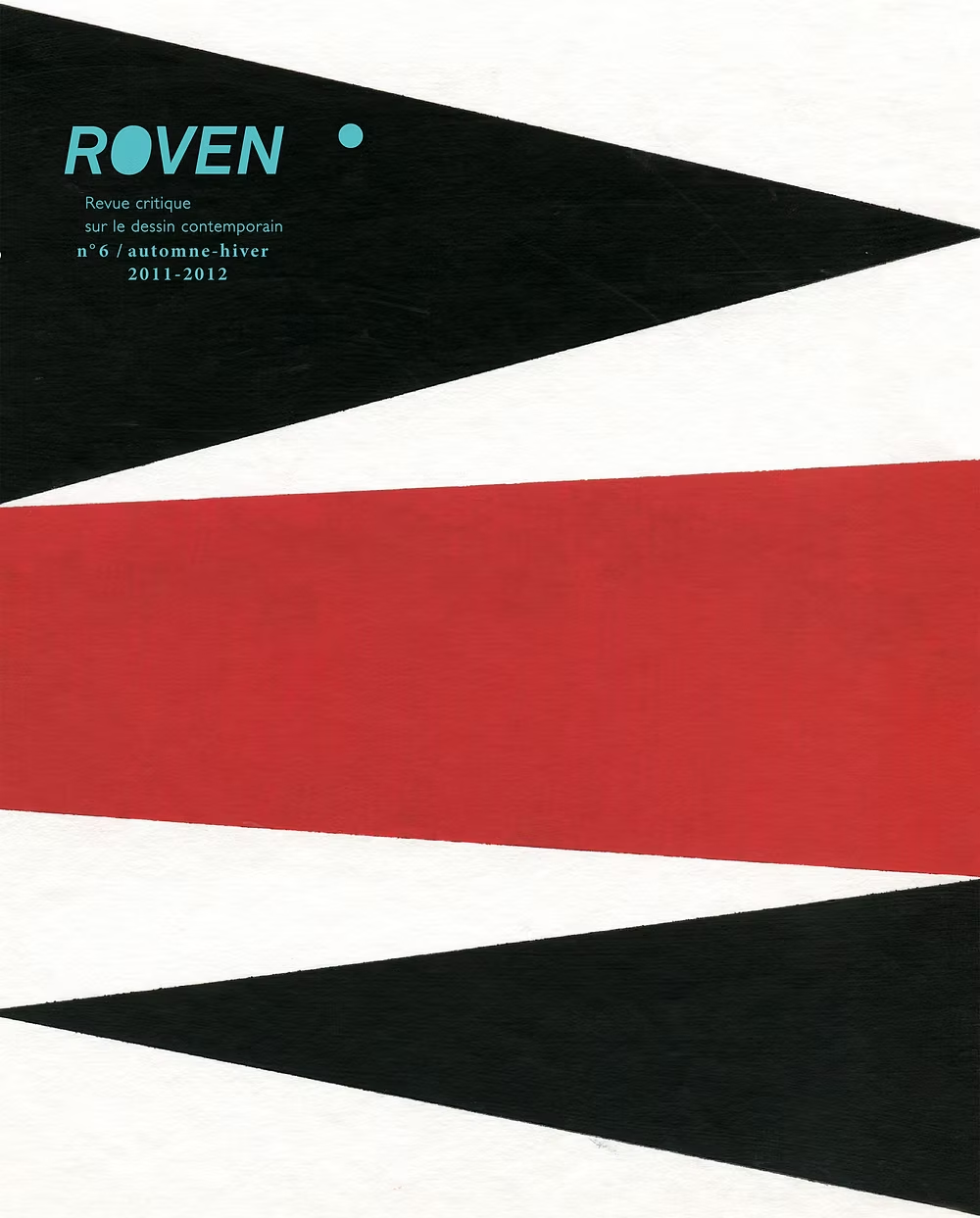L’ivresse captive de Nicolas Muller
par Julie Enckell Julliard
Julie Enckell Julliard : Pourriez-vous retracer le chemin qui vous a conduit à vos projets actuels ?
Nicolas Muller : J’ai eu très tôt le goût du dessin. Je suis entré en école d’art animé d’intentions complètement différentes de celles d’aujourd’hui, pensant me diriger vers l’illustration ou la bande dessinée, comme beaucoup de gens de ma génération bercés par cela. Mais je me suis vite rendu compte de mon incompétence dans ces domaines. Parallèlement, l’école d’art a été un élément déclencheur, me faisant découvrir certains artistes. Je me suis retrouvé dans une classe très dynamique, une chance pour une école de province. Des travaux collectifs ont rapidement émergé.
Nous étions quatre étudiants qui, durant les trois ou quatre dernières années, avons édité pas moins d’une cinquantaine de livres. L’école n’était pas très réglementée, ce qui nous permettait de piller la photocopieuse et l’encre – on restait aussi tard que possible pour relier nos exemplaires en les pliant et en les agrafant ! On tirait cinquante à cent exemplaires, en impression couleur, format A3, un grand luxe ! Ça nous a permis de diffuser notre travail, jusqu’au moment où nous avons rencontré des libraires indépendants. Les premières invitations à des salons sont arrivées. On présentait nos livres et on rencontrait des personnes plus âgées et plus expérimentées. Très vite on a pu entrer dans une pratique de l’exposition. Parallèlement, j’ai participé à la création du collectif « Mucus¹ », qui réunissait sept artistes avec des univers graphiques très différents. On se fédérait pour pouvoir monter ensemble des projets dans des lieux d’exposition en friche ou autre. Cela a duré trois ou quatre ans. Il fallait délaisser nos univers plastiques pour adopter une position de groupe. Cela nous faisait sortir de nos habitudes plastiques, c’était très enrichissant.
J. E. J. : Quels sont ces artistes que vous avez découverts au fil de votre cursus ?
N. M. : J’étais très attiré par des artistes totalement décomplexés comme Jonathan Meese, Albert Oehlen ou Jan Fabre, qui menaient un travail souvent séduisant formellement, me démontrant que beaucoup de choses étaient possibles. Je pense aussi à Bruno Peinado ou à des artistes plus en retrait dont j’apprécie encore énormément le travail, comme Pierre La Police, très actif dans le milieu de l’édition, ou encore FLTMSTPC² qui est à mon sens un des éditeurs indépendants incontournable aujourd’hui.
J. E. J. : Parler de dessin revient souvent à évoquer la simplicité des moyens et un rapport direct et immédiat au travail, celui-ci étant aussi perçu par certains artistes comme une difficulté ou une contrainte.
N. M. : Cette immédiateté m’est nécessaire. Je peux passer plusieurs heures sur un seul dessin, mais ne parviens pas à travailler longtemps en amont sur un logiciel 3D pour réaliser une maquette. J’ai besoin d’entrer directement dans le vif du sujet, de me confronter à la matière et au « travail final », sans passer par toutes ces étapes intermédiaires de textes, pré-projets, etc.
J. E. J. : Interrogé sur sa pratique du dessin, Richard Serra a affirmé qu’elle l’aidait à mieux voir³. Qu’est-ce qui, chez vous, déclenche la réalisation d’une œuvre ? Est-ce la naissance d’une idée que le dessin vous permettrait de mieux discerner ?
N. M. : Le dessin est pour moi une gymnastique nécessaire pour se faufiler dans des failles qu’on vient d’ouvrir et qu’on se doit de creuser. Le premier dessin réalisé après une pause n’est jamais bon. Cela nécessite du temps, de l’essai, du travail. Il faut qu’il y ait du fourmillement, une énergie qui, à un moment, peut aboutir à quelque chose que je juge intéressant.
J. E. J. : Comment surgit l’idée d’un dessin ?
N. M. : C’est très intuitif, lié à la matière. Je regarde ma caisse de peinture et, en fonction de mon humeur, je vais plutôt choisir le pot d’acrylique noir ou le tube de gouache bleue.
J. E. J. : Donc vous partez des outils que vous avez à disposition ?
N. M. : C’est ça. Et comme je suis feignant et que je n’ai pas envie de me lever pour aller laver mon pinceau, toute la série est d’une seule couleur. Quitter ma chaise risque de me faire perdre le fil. Je suis très concentré et je ne lève pas la tête durant trois ou quatre heures.
J. E. J. : En découvrant votre travail, j’ai été frappée par une friction récurrente entre des éléments très rectilignes et d’autres plus aléatoires, entre le très contrôlé et le très sensible.
N. M. : C’est presque schizophrène, comme si j’avais deux déguisements pendant le travail en atelier : le premier serait le Latin sanguin, un peu farfelu et ivre, le second serait le scientifique ou le mathématicien en blouse blanche, intervenant de manière appliquée avec son double-décimètre.
J. E. J. : Le mathématicien vient en seconde position ?
N. M. : Toujours. Il y a d’abord le chaos sur la feuille, l’angoisse de la page blanche qui me poussent à travailler de façon complètement libre. Je prends possession de l’espace de la page avec brutalité et expansion. Je fais presque le travail inverse de celui du maçon qui commence par les fondations et les poutres devant faire tenir le bâtiment. Je me focalise sur le néon ou la lampe de chevet et je construis les murs autour. C’est une manière d’isoler la peinture et de lui rendre un certain hommage. La cadrer avec des traits autoritaires et stricts la met en valeur et la place au centre de mon propos. Dans les dessins au stylo à bille, je parcours la feuille de manière presque carnivore, ce qui me conduit à conquérir son espace rapidement. Je considère par exemple Sans titre (inox et graphite) (2009) comme une frise chronologique, avec une ligne de temps qui, par moments, connaît des situations plus importantes que d’autres, marquées par des tubes en acier inoxydable. Il y a une confrontation entre les deux matériaux, le côté brillant, industriel et froid des barres en inox et le côté plus organique, plus sensible du graphite.
J. E. J. : Vos Tuteurs (2010) suggèrent un geste d’intrusion dans l’environnement d’une plante, dont le déploiement libre connaît soudainement un redressement et se voit remis sur le « droit chemin ». On pense à une sorte de greffe ou d’hybridité…
N. M. : Oui, je me mettais à la place du tuteur qui, peut-être, aurait voulu fusionner avec la plante, avoir lui aussi la possibilité de bourgeonner. Je cherche à rendre vivant l’inerte.
J. E. J. : Dans le prolongement de ces confrontations entre l’« hyperstructuré » et l’« hyperlibre », on remarque un frottement entre des temporalités différentes, allant du très contemporain au très ancien. Cela ressort en particulier dans l’installation Sans titre (Serraval) (2010).
N. M. : Dans ce préau d’école, les poutres déjà très visibles l’ont été encore davantage après l’installation. Le mur du fond était en lambris de sapin. L’aspect très carcéral des poutres m’a incité à en prendre le contre-pied. Cela reflète mon regard sur la manière dont un enfant est socialisé par l’école via l’apprentissage de règles, ce qui m’a toujours paru étrange.
J. E. J. : L’éclatement des pixels représenterait donc le cerveau de l’enfant, très libre, engoncé dans la structure rigide de l’école incarnée par les chevrons ? On retrouve la notion de structure des tuteurs et l’encadrement de vos autres travaux…
N. M. : Cette manière de répondre à une spécificité architecturale m’a permis de rentrer dans la peau du maçon et de comprendre sa proximité avec les matériaux. Autre chose m’a fortement marqué étant jeune : mon père est gardien de prison et nous occupions un logement de fonction dont le jardin donnait sur le mur d’enceinte de la prison. Il y a quelque chose d’assez dur dans la vision du petit sapin qui essaye de se développer en regard du mur de quatre mètres de haut délimitant le périmètre de la prison. C’est resté très présent dans mon esprit. J’ai d’ailleurs proposé plusieurs projets pour intervenir artistiquement en milieu carcéral ; projets qui n’ont, pour l’instant, pas abouti. On a souvent tendance à idéaliser le statut des fonctionnaires ou à considérer les conditions de vie des détenus comme meilleures que celles des sans-abri, car ils ont la douche et la télévision. En réalité, l’univers carcéral doit être effroyable.
J. E. J. : Vous avez un rapport particulier à la figuration : celle-ci n’intervient qu’au travers de références très anciennes, par exemple un tableau de Rubens associé à une structure façon Buren dans Brurens (extraits) (2009). Est-ce qu’à vos yeux, l’adoption d’un langage figuré ne fait pas sens aujourd’hui ? Ne correspond-elle pas à la société technologique dans laquelle nous évoluons ?
N. M. : Il m’est difficile de répondre à cette question. J’ai toujours eu un rapport étrange à l’abstraction, plutôt de haine ou de répulsion. Je la trouvais inintéressante, muette. Mais comme pour beaucoup d’artistes, ce rejet a attiré mon attention et m’a poussé à en connaître davantage, jusqu’au moment où je me suis approprié ces formes qui font partie d’un langage très contemporain. Quant à ces temporalités différentes présentes dans mon travail, elles sont liées aux oppositions architecturales récurrentes dans nos lieux de vie : une HLM située à 200 mètres d’une église fortifiée du XVIᵉ siècle, un centre pénitencier à quelques pas d’une citadelle érigée par Vauban. La structure des paysages urbains et ruraux dans lesquels j’ai vécu est étonnante.
J. E. J. : Dans Sans titre (sol/plafond) (2009), un mur de dessin présentant un fourmillement de traits au graphite, une surface brouillée habillant la paroi du sol au plafond, l’univers de Sol LeWitt et ses dessins muraux conçus comme des structures all over semblent très présents. Faut-il voir une forme d’hommage ?
N. M. : Absolument. Cet artiste fait partie de mes références clés au même titre que Robert Morris.
J. E. J. : On pourrait même voir une deuxième référence dans ce langage de gris qui, de loin, évoque plus un écran neigeux, quelque chose de très technologique, et rappelle certaines pièces de Steven Parrino.
N. M. : C’est aussi une référence très présente, mais je n’y avais pas pensé directement pour cette pièce. Le dessin offre deux points de vue bien distincts. Il se trouvait au bout d’un couloir long d’au moins dix mètres et, de loin, donnait à voir une surface onctueuse, une atmosphère brumeuse et des contrastes assez faibles. Plus on se rapprochait, plus on prenait conscience de la rugosité de la pièce et des surfaces non homogènes. La structure très autoritaire se retrouvait ainsi atomisée par le fourmillement des traits de crayon. Là encore, c’était une manière de faire sauter les verrous et de montrer qu’une forme très fermée et stricte en apparence n’est, suivant l’angle de vue, pas si définitive.
1. Mucus, collectif créé à Metz, actif de 2004 à 2007, composé de Mélanie
Blaison, Corentin Grossmann, Julien Grossmann, Denis Knepper, Amandine
Meyer, Nicolas Muller et Grégory Wagenheim.
2. FLTMSTPC ou Fais-le toi-même si t’es pas content [NdlA].
3. « The more I draw, the better I see and the more I understand », R. Serra
dans l’entretien « About Drawing : An Interview » mené par Lizzie Borden, dans
Richard Serra. Writings, Interviews, Chicago ; Londres, The University of Chicago
Press, 1994, p. 58.
2011, Roven n°6